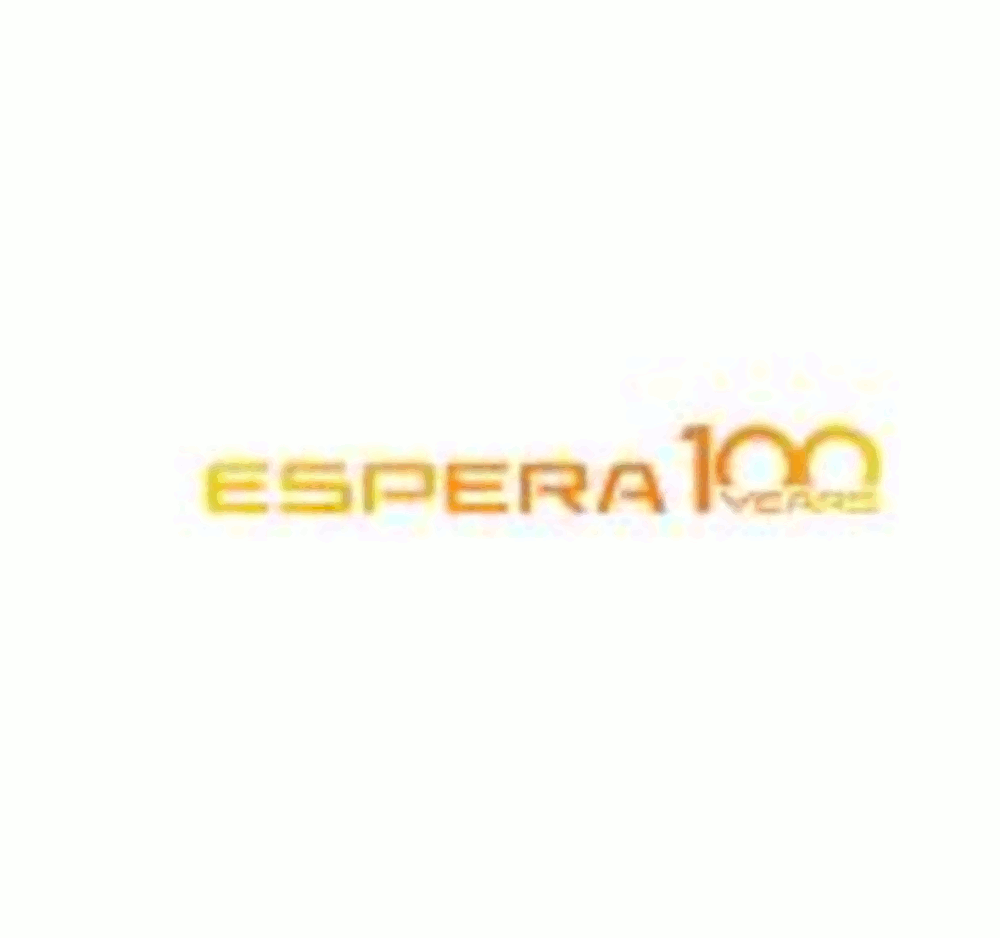LA CLARTE DANS L'EMBROUILLAMINI DES AUDITS
Certifications dans l'industrie agroalimentaire
La certification dans l'industrie agroalimentaire est une donnée inévitable qui concerne chaque maillon de la chaîne, du producteur de base à l'utilisateur final. L'importance et la hiérarchie des diverses certifications ne sont toutefois pas toujours tout à fait claires. C'est pourquoi cela vaut certainement la peine d'esquisser une vue totale schématique au sein de la vaste industrie agroalimentaire des différents niveaux de certification qui existent actuellement, et de leur octroi.
DU BON SENS

La bonne pratique de la standardisation et de la surveillance des processus est bien des siècles plus ancienne que les concepts eux-mêmes.
Quiconque n'enregistre ou ne contrôle rien du tout, ne sait plus à la longue ce qu'il fait, et se perd vite dans son propre désordre. Un processus qui tourne bien, réclame à la fois un système et une méthode. De plus, il réclame aussi la surveillance des standards, une pratique qui est dénommée 'la certification' à notre époque.
LE STANDARD DE BASE
En Belgique, l'autocontrôle fait office de certification minimale. Le système d'autocontrôle (ACS) est un principe permanent et implique une obligation légale. Il s'agit d'une législation totale que tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire doivent certainement suivre. Le contrôle du respect de ces exigences fait partie des compétences de l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Chaque maillon doit mettre en place un système d'autocontrôle, le surveiller de façon adéquate et l'entretenir en fonction de la réalité, et le faire évoluer avec les tendances légales et les éventuelles exigences de la clientèle.
Ce principe, qui part de la surveillance et de la vérification des diverses étapes et opérations dans un processus, constitue la base du fonctionnement du système de la sécurité alimentaire dans notre pays. Il représente le minimum légal.
CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES
Sur cette certification de base peut ou peuvent se superposer un ou plusieurs standards 'commerciaux'. Des exemples connus sont les BRC, IFS, ISO22000, FSSC et autres. Ces standards permettent aux entreprises concernées d'orienter leur vente vers un marché très spécifique.
Dans une phase de certification encore supérieure, l'obtention ou la conservation d'un label spécifique peut en tout cas être l'objectif visé.
Connue est la labellisation des méthodes de culture biologiques pouvant être greffées de façon hiérarchique au-dessus des normes précitées. La labellisation vise dans ce cas une caractéristique de qualité spécifique, pas la sécurité alimentaire.
En effet, on veut garder et assurer une identité unique. Du point de vue hiérarchique, ce type de certification ou label est subordonné à la certification de base, qui repose sur l'autocontrôle.
L'IMPORTANCE DES AUDITS

L'objectif des audits est double. D'une part, la validation d'un système d'autocontrôle par l'AFSCA elle-même et, d'autre part, la certification d'un système d'autocontrôle par un OCI, lui-même accrédité par l'organisme d'accréditation belge BELAC et reconnu par l'AFSCA.
IMPACT FINANCIER
N'importe quel acteur de la chaîne alimentaire peut donc faire valider son système d'autocontrôle par un organisme de certification agréé, qui vérifiera ceci sur la base d'un audit sur place.
Lorsqu'il est constaté que le producteur opère en totale conformité avec la législation en vigueur, l'AFSCA le fera bénéficier d'un avantage préétabli qui se traduit par une réduction sur la cotisation annuelle payée à l'AFSCA en tant que producteur.
LE FIL ROUGE
Pour soutenir et aider les entreprises à entretenir leur système d'autocontrôle, les différentes fédérations de la vaste industrie agro-alimentaire mettent un guide 'Autocontrôle' à disposition.
Ceci est un aperçu de toutes les exigences légales - minimales - applicables dans le secteur.
De plus, ce guide est aussi la référence qui sera utilisée pendant les audits pour vérifier si l'entreprise opère bien conformément aux exigences légales. Chacun de ces guides a été bien entendu validé et approuvé par l'AFSCA.
En plus de l'autocontrole legalement obligatoires, on peut encore implementer des normes et standards commerciaux, imposes par les clients
STANDARDS COMMERCIAUX
Les standards commerciaux sont en principe tous les standards privés, pour lesquels le client peut exiger de son fournisseur que celui-ci certifie sa conformité. En plus du standard de base, on peut implémenter notamment les normes et standards BRC, IFS, ISO et FSSC. En fait, ceux-ci préservent l'harmonie entre les différents secteurs.
Le BRC, par exemple, est la référence britannique mise en avant comme norme privée par les détaillants plus grands. L'IFS est un standard qui domine surtout en Allemagne. Le FSSC 22000 est aussi un standard qui part d'une structure très délimitée, mais est essentiellement appliqué aux Pays-Bas.
REPARTITION

Quand on parle de standards commerciaux, on peut scinder le paysage grosso modo en d'une part la certification de produit et d'autre part la certification du système de gestion.
Certification de produit
L'approche dans les deux variantes est clairement différente. La BRC et l'IFS sont par exemple des certifications de produit typiques.
Ceci signifie concrètement le suivi d'une check-list particulièrement détaillée relative au produit dans le but de vérifier si l'entreprise répond bien aux conditions censées conduire au final à un certificat. Nous parlons donc ici clairement d'un processus très systématique et détaillé, pour lequel le contenu de la check-list est imposé par le titulaire du manuel, le plus souvent le client.
Certification du système
En parallèle, nous distinguons également une certification de système. On vise de façon conséquente le système de gestion proprement dit, pas le produit définitif. Le FSSC est un bon exemple.
Concrètement, on examine si l'entreprise est capable de commercialiser un produit qui répond aux exigences posées par le biais de son propre fonctionnement. En d'autres termes, c'est une approche ISO marquée. Tout ce qui est ISO, reste très général, parce que la normalisation est basée sur le processus. Le mode de fonctionnement de l'entreprise doit être suffisamment systématique pour pouvoir répondre aux exigences de la norme ISO. Ainsi, le FSSC 22000 découle de l'ISO 22000 et une autre norme, la 22002, qui explique comment appliquer l'SO 22000 dans l'environnement de l'entreprise. La troisième (petite) partie du FSSC concerne des caractéristiques particulières, exigées par le FSSC lui-même. Songez à la gestion autour des allergènes, de la fraude alimentaire, de la défense alimentaire et autres.
Certifications vers le maintien de l'identité
En plus de ces deux sondeurs de base, on greffe souvent comme troisième niveau des certifications qui garantissent le maintien de l'identité des produits de base. Ceci implique de facto une plus grande traçabilité. Des exemples connus sont les labels tels que GMO-Free, BIO etc.
De nouveau, ce type de certifications n'est absolument pas pertinent tant que les bases de l'autocontrôle ne sont pas respectées. Dans le cas du maintien de l'identité, l'engagement porte en tout cas, en outre, sur la qualité du produit et pas sur la sécurité alimentaire.
AUDITS
La vérification de la conformité au sein d'une organisation s'effectue au moyen d'un audit. Chaque audit est un processus systématique, préventif qui doit se baser sur des informations concrètes.
Ce sont toujours des faits et des chiffres. On évalue les processus utilisés par rapport à la norme. On évalue toujours par rapport à une référence légale.
L'audit est exécuté de façon indépendante et objective par rapport à l'entreprise auditée, en mettant en lumière des données qui indiquent la conformité ou la bon-conformité. La tâche de l'auditeur consiste à documenter et étayer les observations de façon univoque et sans laisser aucune place à l'interprétation.
LE PRINCIPE EVOLUTIF
Les certifications évoluent et suivent la croissance, en fonction de l'évolution des marchés et aussi parce que les risques dans le marché évoluent eux-mêmes. Ce faisant, le manuel de base inclut de plus en plus des addenda adaptés aux nouveaux développements.
Pour le BRC, par exemple, on en est en ce moment à la septième version, tandis que l'IFS souffle déjà ses six bougies. Au sens strict, ceci revient à une adaptation ou actualisation tous les deux ans.
Global food safety initiative
La FSCC22000 a récemment évolué vers sa version 4.1. Et pourquoi cette norme évolue aussi? Parce que quelque chose comme le GFSI (Global Food Safety Initiative) existe.
C'est le regroupement de tous les représentants des standards de certification dans le secteur alimentaire. Il implique une équivalence internationale. En effet, qu'une entreprise soit certifiée BRC en Belgique, en France ou aux USA, sa certification doit toujours rester équivalente. Le GFSI garantit cette équivalence, ce qui fait que la norme de base est régulièrement remaniée.
FERS DE LANCE
En principe, l'auditeur évaluera simultanément les différents niveaux de certification, compte tenu de la hiérarchie naturelle entre les certifications mutuelles.
Si, par exemple, une entreprise labellise 'BIO' une seule ligne de produit, l'ensemble des lignes de production sera en tout cas audité; avec un accent complémentaire sur la traçabilité de cette ligne, de la logistique des marchandises entrantes à l'expédition du produit fini.
Un audit visera aussi toujours quelques sujets de base, comme par excellence le processus d'amélioration continue du type 'plan-do-check-act' au sein de chaque organisation concernée.
QUELLE DUREE?
La durée d'un audit dépend bien entendu de certains paramètres, tels que la taille de l'entrepri

se, son activité, la valeur ajourée, l'historique et le risque éventuel pouvant être associé au produit ou aux activités. Pour chaque cas-type, il existe au sein du secteur un fil conducteur qui fixe une durée minimale raisonnable d'un audit.
NON-CONFORMITES
En cas de non-conformités, l'entreprise auditée devra toujours présenter un plan d'actions correctives censé les anticiper de façon curative et en principe aussi préventive. En fonction de la gravité de la non-conformité, soit on interviendra aussitôt, soit on adoptera un série de mesures dans un délai fixé, dont l'efficacité sera démontrée. Dans certains cas sérieux, la norme définit même le délai maximal pour y remédier.
Lorsque l'auditeur marque son accord sur les mesures postulées, il les inclura dans son rapport et enverra ceci à la Commission de Certification correspondante. Ceci est un organe neutre qui se penchera sur le rapport et enverra un conseil professionnel à l'organisation. Ce conseil peut suivre ou contredire les suggestions de l'auditeur. Dans certains cas spécifiques, des données complémentaires sont demandées, avant d'aboutir à un certain conseil. Un post-audit censé vérifier que l'entreprise a bel et bien suivi le plan d'actions, peut également être exigé. Dans des cas extrêmes, une décertification est aussi décidée.
L'AUDITEUR AUDITE
Tous les organismes de contrôle belges, accrédités pour exécuter des audits selon un cahier des charges précis, sont à leur tour audités par l'organisme coordinateur BELAC. Ils peuvent agir uniquement comme organisme de contrôle 'agréé'.
En ce qui concerne les initiatives et mesures, la certification d'un produit peut etre plus simple que celle d'un systeme
PROCESSUS DE CONTRÔLE CONTINU
L'organisme de certification a à tout moment le droit d'exécuter des audits. Ceci parce qu'une certification n'est qu'un instantané, basé sur l'audit le plus récent.
La validation réelle d'un certificat est fonction de l'autocontrôle continu qu'effectue l'entreprise elle-même. Un système de qualité qualitatif surveillera donc de façon inhérente le propre fonctionnement en vérifiant de nombreux aspects et en procédant à des analyses causes-conséquences sur une base permanente.
AUDITS ET HACCP
Un sondeur important au sein de l'autocontrôle est le HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Ceci sera passé au crible dans le cadre d'un audit de système. Les enregistrements sont également visés, et surtout la façon dont les écarts sont traités. L'audit se concentrera en particulier sur l'analyse des risques originale et la comparera à la législation qui définit les CCP dans le processus. Si certains points critiques n'ont pas été repris comme tels dans l'analyse des risques, ceci doit en tout cas être justifié par rapport à l'auditeur. Ceci peut rendre la certification d'un produit nettement plus simple que celle d'un système.
En effet, lors d'une certification d'un système, l'entreprise alimentaire doit sans aucun doute prendre toutes les initiatives et mesures pour parvenir à un produit fini conforme, tandis que, dans un audit de produit, les prédéfinitions font loi.
Avec la collaboration de Quality Partner